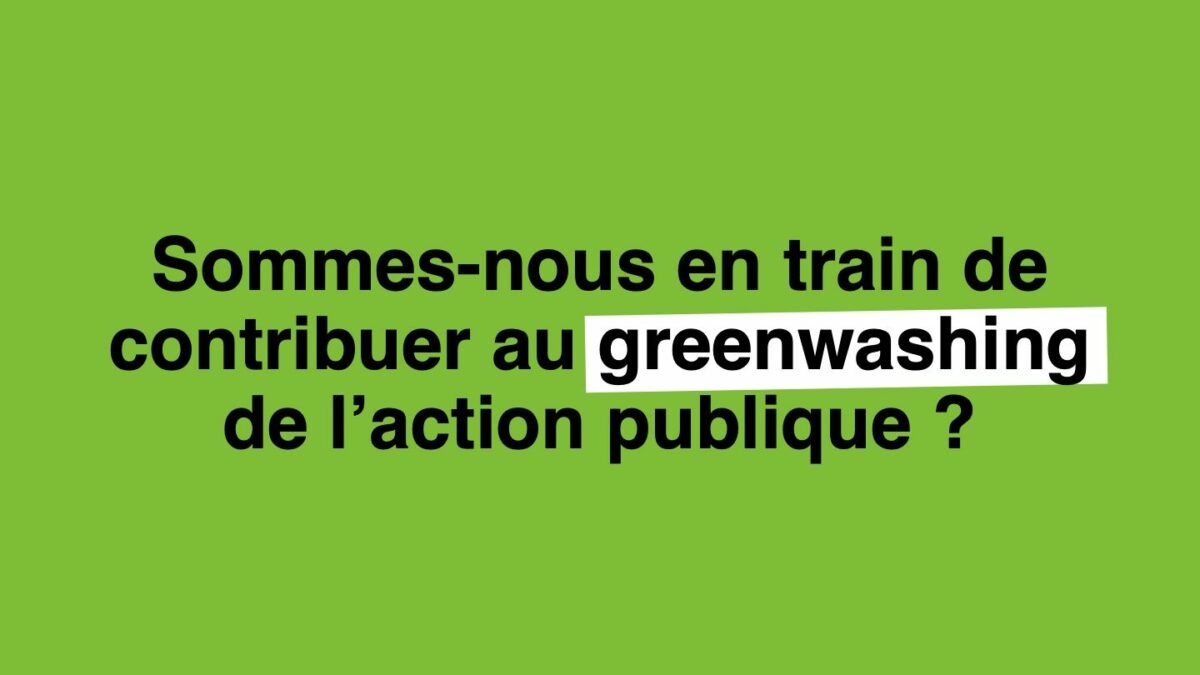Sommes-nous en train de contribuer à une forme de greenwashing de l’action publique ? Cette question n’est pas une provocation, mais une angoisse professionnelle croissante. Elle nous prend à chaque fois qu’on ouvre notre fil LinkedIn. La transition écologique y est omniprésente : pas un jour sans un colloque sur le sujet, l’annonce d’une feuille de route stratégique ou le lancement d’une nouvelle démarche. Leur élaboration occupe d’ailleurs une part croissante de notre activité.
Cette agitation sur les politiques de transition contraste avec l’évolution de la situation écologique. Alors que les effets du dérèglement climatique s’accélèrent et que ses causes persistent, les efforts déployés dans les collectivités pour amplifier la transition écologique apparaissent dérisoires. A quel moment faut-il considérer la multiplication des documents stratégiques comme un moyen de masquer l’inaction ?
Ce sentiment de décalage, voire de dissonance, nous conduit à prendre le sujet dans l’autre sens. La question est moins de savoir comment amplifier la transition écologique mais pourquoi on n’y arrive pas (ou si peu). En assumant à ce stade que le « on » reste vague, pour permettre à chacun de s’y identifier. Et en commençant par se l’appliquer à notre activité quotidienne : le conseil en stratégies territoriales.
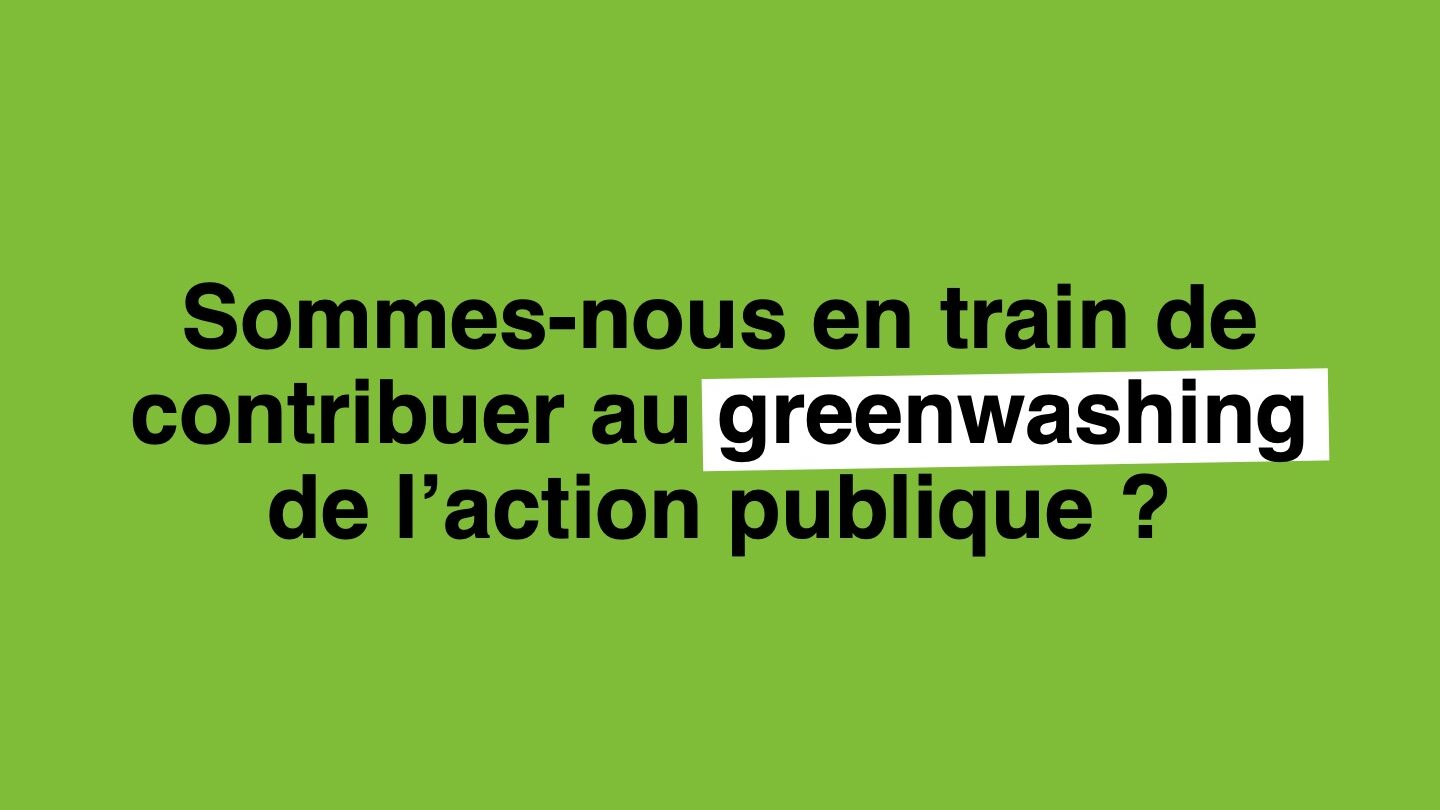
La liste des raisons de ce qui jusqu’ici ressemble à un échec serait longue, et dépasse largement notre périmètre d’intervention. A notre niveau, on en identifie trois principales. Comme une invitation à prolonger l’exercice et à le compléter par d’autres points de vue.
Une focalisation sur les bonnes pratiques mais une incapacité à remettre en cause les mauvaises pratiques
On ne compte plus les guides, formations et autres référentiels destinés à outiller les collectivités en matière de transition écologique. A chaque fois, il s’agit de montrer que « c’est possible » à travers des retours d’expériences et la valorisation d’actions exemplaires : approvisionnement des cantines en circuits courts bio, mobilisation des bâtiments publics pour produire des énergies renouvelables, mise en place de stratégie zéro déchets, formation des agents aux enjeux climatiques, et cetera…
Les bonnes pratiques sont à l’action publique ce que les éco-gestes individuels sont à la consommation : une réponse au besoin d’agir à l’impact incertain, qui se transforme en injonction culpabilisante et/ou en stratégie de diversion pour éviter d’avoir à remettre en cause des mécanismes plus structurels. On continue à penser la transition écologique comme une politique supplémentaire qui s’ajoute aux autres (comme la RSE dans le monde de l’entreprise), et non comme un virage qui nécessite de requestionner l’ensemble des actions mises en œuvre.
En termes de neutralité carbone ou de préservation du vivant, les principaux leviers des collectivités sont davantage du coté des actions néfastes que des bonnes pratiques. Car en matière écologique, l’action publique locale n’est pas toujours vertueuse. Elle contribue à la surconsommation des ressources, à l’artificialisation des sols ou à la mise en vulnérabilité des territoires face aux risques. Ce n’est pas un hasard si le mouvement climat concentre sa mobilisation sur la lutte contre les « grands projets inutiles et imposés ».
Que faut-il arrêter ou réduire ? Voilà ce qui devrait être au cœur de la feuille de route des collectivités pour amplifier la transition écologique. Mais la question reste souvent tabou. Elle illustre notre difficulté collective à faire le deuil d’un logiciel de développement local hérité des années 1990. Les tentatives de détricotage du ZAN témoignent de la difficulté à tenir la contrainte, face à la pression du local pour maintenir le statu quo.
La focalisation sur la construction d’une vision partagée mais une incapacité à assumer des intérêts divergents
Les démarches de transition écologique sont obsédées par la construction d’un « récit désirable ». A partir de l’hypothèse suivante : si les politiques de transition peinent aujourd’hui à produire leurs effets ou à être acceptées, c’est car elles ne parviennent pas à fédérer la population autour d’un récit mobilisateur. L’urgence serait de bâtir d’autres imaginaires souhaitables, pour mettre en mouvement la société.
On comprend bien la nécessité d’agir sur les représentations, pour éviter de réduire la question écologique à une somme de diagnostics désincarnés ou de contraintes technocratiques. Ce qu’on observe néanmoins, c’est que la quête du « récit désirable » est régulièrement instrumentalisée par les institutions pour euphémiser l’ampleur du problème et retarder le passage à l’action.
La crainte de faire peur (ou la volonté de rassurer) participe d’une forme de déni climatique, au détriment d’une demande de lucidité exprimée par un nombre croissant de citoyens et de professionnels. Quand la maison brûle, on cherche à savoir d’où vient l’incendie et à trouver l’issue de secours. Pas à un lancer un dessin animé pour éviter que les enfants paniquent.
Plus que l’absence de récit désirable, la transition écologique bute sur la difficulté de l’action publique à assumer les divergences d’intérêts (entre acteurs mais aussi en leur sein). « L’écologie ne nous rassemble pas, elle nous divise » comme l’affirme Pierre Charbonnier. Loin d’être un objectif consensuel, les politiques de transition agissent comme un révélateur de nos divergences. La gestion des tensions sur la ressource en eau en est l’illustration. A mesure que les effets du dérèglement climatique deviennent réalité, le clivage se déplace sur la nature des actions à mettre en place pour y faire face. L’opposition n’est pas entre ceux qui parlent d’écologie et ceux qui n’en parlent pas (tous les exécutifs se revendiquent comme les champions du verdissement), mais entre les solutions mises en œuvre et leurs critères d’évaluation (faut-il regarder en priorité l’impact sur le PIB ou sur les inégalités ?).
L’inefficacité des démarches stratégiques sur les politiques de transition découle de leur dépolitisation. Comme si l’écologie n’était qu’une affaire d’ingénieurs, focalisés sur la recherche de solutions techniques pour atteindre la neutralité carbone. Pour parvenir à amplifier nos capacités de transformations, ces démarches pourraient davantage être mobilisées comme des espaces de négociation. Ce qui passe par la confrontation des parties en présence sur chaque territoire et de leurs intérêts, pour bâtir des coalitions d’acteurs qui s’engagent à mettre en œuvre les orientations retenues (et pas uniquement à afficher des objectifs purement incantatoires).
Les institutions se confrontent à un impératif de lucidité, tant sur l’ampleur des effets locaux du dérèglements que sur les conflits qu’ils vont immanquablement susciter dans les territoires. Au risque sinon de perdre en crédibilité à mesure que la situation se tend sur le terrain et de se retrouver démonétisées dans sa capacité à dire le risque et à dicter le cadre.
La focalisation sur les enjeux environnementaux mais une incapacité à aborder les péréquations financières
La préservation de la biodiversité et l’atténuation/adaptation au dérèglement climatique, c’est comme la santé : ça n’a pas de prix, mais ça a un coût. Dont on commence seulement à mesurer l’ampleur, tant les chiffrages sont astronomiques. Le déploiement des politiques de transition sur le terrain en donne aussi un aperçu, de manière plus tangible : le coût du remplacement d’un véhicule (dans le cas des ZFE), le manque à gagner lié au déclassement d’une parcelle classée « à urbaniser » (dans le cas du ZAN), le cout de changement d’une chaudière (pour sortir des énergies fossiles) ou de la construction d’une piste cyclable, etc.
La question n’est pas uniquement d’estimer combien ça coûte, mais surtout de savoir qui va payer. Doit-on faire financer l’amélioration de la qualité de l’air par les ménages (souvent précaires) qui roulent en diésel ? La lutte contre l’artificialisation des sols va-t-elle se faire aux dépens de la retraite des agriculteurs (qui comptent sur la plus-value foncière de l’extension urbaine pour financer leurs vieux jours) ? La transition écologique est aussi et avant tout un sujet d’allocation de la ressource, et de sa redistribution.
Alors que tout le monde s’accorde à dire que la transition écologique doit aussi être sociale, la question redistributive reste un angle mort des politiques mises en œuvre. Les choses commencent doucement à bouger au niveau national, comme en témoigne le rapport Mahfouz/Pisani-Ferry. Au niveau local, on en est encore loin. Quand est-ce qu’on parlera fiscalité locale dans les plans climat ?
—
Que faire une fois ces constats posés pour éviter de sombrer un peu plus dans l’écoanxiété ? No sé. Mais à ce stade, on se dit que notre planche de salut viendra plus de la lucidité du doute que de la recherche de solutions. Pris dans l’agitation permanente face à l’urgence climatique, nous éprouvons le besoin de prendre du recul sur l’impuissance des collectivités et de l’Etat à amplifier la transition. D’ouvrir l’espace du doute de manière plus collective pour développer nos capacités d’auto-défense contre le greenwashing de l’action publique.