Le texte ci-dessous restitue les 5 enseignements que nous retenons de notre expérimentation sur les COPIL, avec la Ville de Palaiseau, la Métropole de Lyon et la mutuelle Mutlog. Nous y partageons aussi des conseils pratiques et un aperçu de ce qui reste à travailler. Pour mettre toute cette matière en discussion, nous organisons une visio collective le 8 octobre de 15h30 à 17h. Pour y participer, il suffit de s’inscrire ici. Bonne lecture !
—
En juin 2024, dans le prolongement de notre livre sur la démocratisation de l’action publique, nous proposions de lancer une expérimentation sur les comités de pilotage. Avec le constat que les COPIL ont beau être omniprésents dans le quotidien des collectivités locales, leur format (et leur fonction) est rarement questionné.
Depuis, rien ne s’est vraiment passé comme prévu. On a d’abord été surpris par l’engouement suscité par la proposition : plus de 350 inscrits à la visio de lancement (montée à la va-vite en pleine dissolution) et des dizaines de témoignages sur la nécessité de retravailler ce passage-obligé de l’action publique qui met tout le monde en souffrance (agents, élus et consultants).
Puis on s’est demené pendant six mois pour trouver des partenaires volontaires pour co-porter la démarche et contribuer à son financement. Sans grand succès… Beaucoup de personnes curieuses de voir ce que ça pourrait donner, mais peu d’institutions prêtent à mettre ce sujet au-dessus de la pile des chantiers. Signe que cela reste plus facile d’innover en matière de participation citoyenne que de démocratisation interne…

vous pouvez télécharger la synthèse de la visio de lancement
La perche tendue n’aura pas été vaine pour autant, et trois terrains d’expérimentation ont progressivement émergé : une ville de l’Essone qui s’interrogeait sur la façon d’associer les élus à la mise en œuvre de son plan vélo ; une grande métropole qui lançait une convention citoyenne sur l’adaptation aux canicules ; et plus inattendu encore, une mutuelle en pleine réflexion sur sa gouvernance interne et le fonctionnement de son conseil d’administration. Merci à elles d’avoir pris le risque !
Trois configurations aussi hétéroclites que convergentes sur la problématique abordée, avec qui nous avons pu mettre nos hypothèses à l’épreuve, confronter nos analyses et tester des formats atypiques. De cette année d’exploration, nous avons cherché à en tirer un premier bilan pour en partager les enseignements. Ce travail de capitalisation mené en autoproduction n’est pas aussi abouti qu’on l’aurait voulu, mais il aura le mérite d’exister. En espérant qu’il vous soit utile, et que cela donne l’envie à d’autres collectivités de poursuivre l’aventure !
Disclaimer : le texte qui suit est une relecture partielle et partiale des trois expérimentations, il n’engage que ses auteurs. Il est évidemment imprégnée de notre réflexion au long cours sur le bon fonctionnement démocratique des collectivités, sur la fonction représentative des élus et sur le partage des rôles entre le technique et le politique.
Mettre les COPIL sur l’établi pour en clarifier la fonction
L’expérimentation n’a pas pris la forme qu’on avait imaginé au départ. La méthodologie initiale consistait à croiser les regards des différentes parties prenantes des COPIL pour en décortiquer les (dys)fonctionnements, pour tester ensuite d’autres modalités d’animation en s’inspirant des outils de l’éducation populaire.
Au final, nous avons peu animé de COPIL. Vus les contextes, cela aurait été prématuré. On s’est orienté vers un format plus hybride d’ateliers entre élus, pour se tenir à distance du formalisme des COPIL officiels.
Surtout, on s’est vite rendu compte que les problèmes d’animation (bien réels) découlaient d’un flou sur la fonction de ces instances. Pour régler le « comment ça fonctionne ? », il nous fallait d’abord travailler le « à quoi c’est censé servir ? ». C’est sur l’identification du « besoin de COPIL » que le croisement des expérimentations s’est avéré le plus fructueux. Et c’est donc comme cela que nous vous proposons d’en structurer le retour d’expérience, en dépliant les cinq fonctions mise en avant sur le terrain.
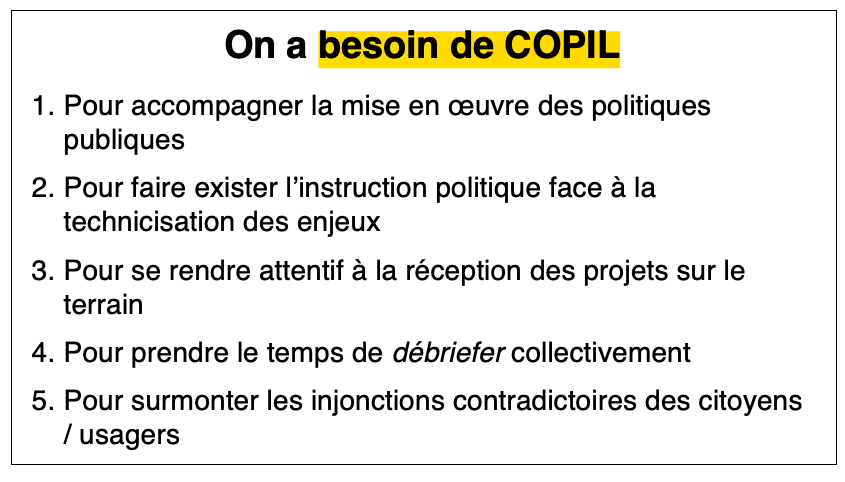
Dans les pages suivantes, nous revenons sur chacune de ces fonctions, à partir de ce que nous avons appris de nos trois terrains. Ces enseignements, nous avons tenté de les décliner en conseils pratiques pour que vous puissiez vous en saisir. En étant bien conscient qu’on est loin d’avoir épuisé ce chantier de longue haleine, et qu’il reste encore pas mal de choses à travailler.
Les trois terrains d’expérimentation
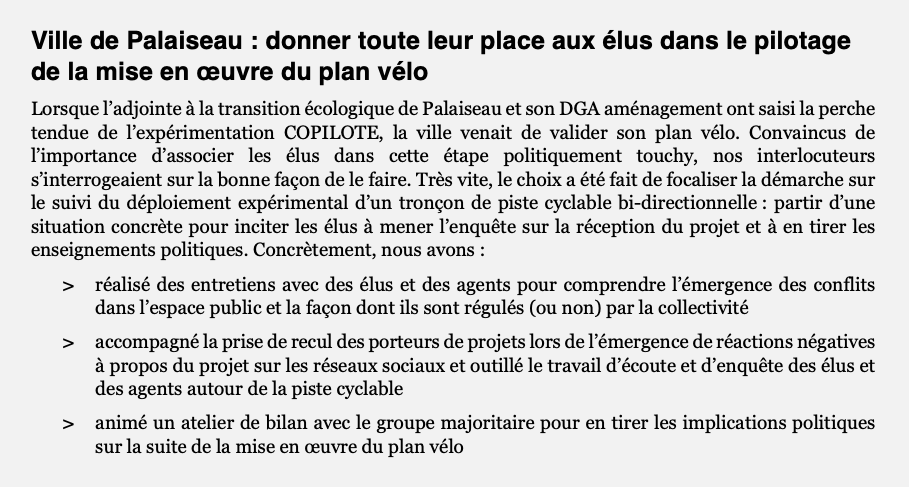
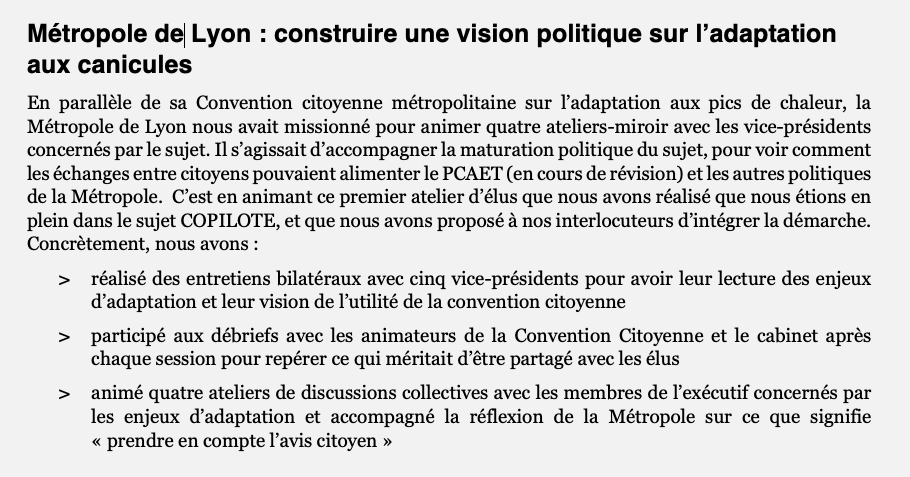
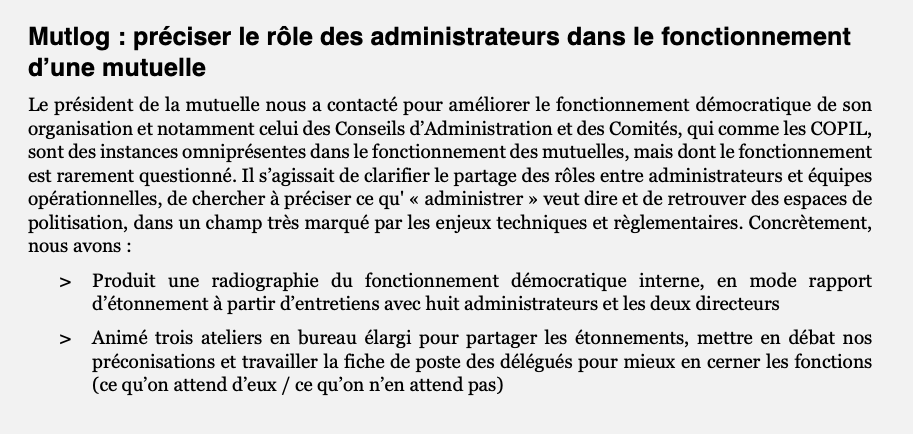
1/ On a besoin de COPIL pour accompagner la mise en œuvre des politiques publiques
Habituellement, la mise en place de COPIL est souvent associée à l’élaboration des plans stratégiques (PLH, PCAET, PLUi…) pour en définir les grandes orientations. Nous avons donc été surpris quand la ville de Palaiseau nous a proposé de focaliser l’expérimentation COPILOTE sur la mise en œuvre du plan vélo. Non pas sur l’élaboration du plan (qui avait fait l’objet d’une concertation importante avec une forte mobilisation des élus, des citoyens et des associations de cyclistes) mais bien sur son déploiement opérationnel, du fait de multiples crispations que cela faisait émerger sur le terrain.

Ce déplacement est intéressant, car il vient remettre en cause la division du travail implicite selon lequel les élus seraient en charge de concevoir la stratégie et les services en charge de la mettre en œuvre. L’exemple du plan vélo de Palaiseau souligne l’imbrication des deux : la stratégie pose des questions de faisabilité technique, et la mise en œuvre pose des questions d’acceptabilité politique. Il est donc indispensable d’associer les élus au pilotage de la mise en œuvre.
A Lyon, le choix a été fait de travailler la cohérence des politiques déjà mises en œuvre par la métropole (pour voir si elles contribuent, ou non, à réduire la vulnérabilité du territoire au risque canicule) et leur adéquation avec les besoins des habitants de la métropole exprimées lors de la convention.
Cet accent sur la mise en œuvre vient repositionner la vocation des COPIL et leur temporalité, pour en faire un outil de suivi sur toute la durée du processus. Piloter, ce n’est pas uniquement planifier a priori, c’est organiser tous les ajustements nécessaires chemin faisant en fonction des réactions que chaque politique suscite, des imprévus qu’elle rencontre, des évolutions du contexte qui obligent à changer de fusil d’épaule…
Si tant est qu’on se rende attentifs à ces imprévus et ces incidents. Et que les services qui y sont confrontés en informent les élus. C’est d’ailleurs un des points de débat apparu entre administrateurs et techniciens dans les ateliers conduits à Mutlog : « le reporting des incidents est-il un enjeu technique ou politique ? » Et les participants de constater que les services ont tendance à ne signaler que les gros blocages, alors que la somme des petits incidents est aussi riche d’enseignements pour avoir une meilleure compréhension des dysfonctionnements.
An fond, l’enjeu du COPIL est moins d’élaborer une stratégie in abstracto que de travailler les décalages entre les intentions de départ et la réalité de leur mise en pratique, que ce soit les conflits d’usage de l’espace public générés par de nouveaux aménagements cyclables ou la gestion des pics de chaleur dans les écoles et les EHPAD.
Conseil pratique : lister les chantiers de mise en œuvre nécessitant discussion stratégique
Pour limiter le nombre de COPIL, il faut assumer d’être sélectif en ciblant ce qu’il faut regarder de près avec les élus. Sachant que des petits objets ordinaires constituent souvent de bons échantillons pour aborder des problèmatiques plus vastes tout en restant concret. Voici quelques critères pour travailler la sélection :
Où sont les points de crispation que vous anticipez ?
Quels sont les projets qui ont vocation à poser un cadre qui va ensuite être dupliqué ?
Sur quel chantier le décalage entre scénario planifié et mise en œuvre doit être travaillé ?
Reste à travailler : le périmétrage (temporel et thématique) des COPIL.
Qu’est-ce qui justifie la mise en place d’un COPIL dédié, et à quel moment y mettre fin ? On pourrait imaginer un système de quota déterminé par la capacité des élus à y prendre part : pour ouvrir un chantier, il faut forcément en refermer un autre.
Faut-il avoir un COPIL par chantier (au risque de les démultiplier et de fragmenter les enjeux) ou chercher à les réunir dans des approches plus transversales ? La question s’est posée à Palaiseau : aborder les conflits d’usage sur la voirie au prisme d’un COPIL « plan vélo » oriente fortement la façon d’appréhender le sujet. Ne serait-il pas plus pertinent de mettre en place une instance de médiation pérenne en charge de traiter l’ensemble des conflits d’usage liés à l’espace public ? Dans ce cas, où est la frontière entre COPIL et commissions municipales ?
2/ On a besoin de COPIL pour faire exister l’instruction politique face à la technicisation des enjeux
Les COPIL sont le plus souvent pensés comme un temps de restitution du travail des agents devant les élus. « Une fois sur deux, le compte-rendu du COPIL correspond au PPT déroulé par les services » remarquait la première adjointe de Villeurbanne lors du lancement de notre expérimentation, « signe que la discussion n’a pas vraiment eu lieu. » Cette technicisation des enjeux s’avère problématique, car elle conduit les élus soit à se mettre hors-jeu (« on n’y comprend rien »), soit à se transformer en super-chef de service (« il y a une erreur de chiffre slide 62 »).
L’expérimentation souligne au contraire l’intérêt (la nécessité !) de faire exister l’instruction politique des actions portées par la collectivité, en vis-à-vis de l’instruction technique. Il s’agit de penser les COPIL comme un espace pour permettre aux élus de faire leur travail représentatif, de se faire le relai des préoccupations entendues de la part de leurs concitoyens pour les confronter à l’expertise technique de l’administration.
C’est que nous avons testé à Lyon, en dissociant les ateliers miroir de la convention citoyenne (pour permettre aux VP d’échanger sur un mode informel sur ce qu’ils retiennent de la délibération citoyenne et les implications à en tirer sur les politiques menées) et le COPIL PCAET (utilisé par les services pour restituer aux élus les diagnostics et la feuille de route en cours d’élaboration).

A Palaiseau, l’exercice a permis de souligner que la création d’une piste cyclable n’est pas qu’une question technique le nombre de potelets de sécurité ou sur le choix du type de revêtement, mais qu’elle correspond aussi à des choix d’allocation de l’espace public. Elargir une piste cyclable revient forcément à réduire l’emprise au sol d’un autre mode de déplacement (voiture, bus, marche à pied). C’est bien parce qu’elle se confronte à des intérêts divergents (qui ont chacun leur légitimité) qu’elle mérite d’être discutée politiquement.
Au sein de Mutlog, c’est l’entrée par les controverses qui a favorisé le passage d’une instruction technique à une instruction stratégique : « que faire des excédents de trésorerie quand on est un acteur mutualiste ? Jusqu’où veut-on développer le lien avec les courtiers grossistes ? » Sur ces sujets d’apparence technique, il s’agissait de rendre visible la variété des orientations possibles pour inviter les administrateurs à construire une position commune et argumentée.
Conseil pratique : compléter en séance le tableau « qui perd ? qui gagne ? »
Chaque projet d’action publique se retrouve confronté à des intérêts divergents et des injonctions contradictoires. Pour naviguer avec, il est nécessaire de prendre le temps de les décrypter et d’en souligner la portée politique. Il s’agit de demander aux élus de mobiliser ce qu’ils ont capté sur le terrain pour le ranger en deux colonnes :
Qui s’estime perdant et pourquoi ?
Qui s’estime gagnant et pourquoi ?
Face à ces tensions, il s’agit moins de trouver la solution techniquement optimale (elle n’existe pas) que de définir la ligne d’équilibre majoritaire qui soit politiquement acceptable. Basique mais pas si facile à remplir, ce tableau fonctionne quel que soit le projet concerné.

mai 2025 à Palaiseau
Reste à travailler : la mise en dialogue entre technique et politique
Pour faire exister ce travail d’instruction politique, nous avons vite compris que nous avions besoin d’un espace d’échange entre élus, qui ne soient pas animés par les services (qui étaient soit absents, soit en observation). De la même manière que l’administration a besoin d’un COTECH pour préparer un COPIL, les élus ont besoin d’un temps préparatoire en non-mixité (le COPOL ?).
Ce n’est qu’une fois que ces deux types d’instruction ont été travaillées qu’on peut organiser leur mise en dialogue de manière à creuser la complémentarité de ces deux registres dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques. La démarche COPILOTE ne nous a pas permis d’aller jusque-là… Clarifier le partage des rôles entre élus et techniciens, ça prend du temps !
3/ On a besoin de COPIL pour se rendre attentif à la réception des projets sur le terrain
Organiser « l’instruction politique », d’accord, mais concrètement, qu’est-ce que ça veut dire ? C’est surtout là-dessus que s’est concentrée l’expérimentation de manière à outiller le travail d’enquête des élus. Nous faisons en effet l’hypothèse que les COPIL peuvent être un levier pour renforcer la capacité d’écoute des institutions (en complément des dispositifs participatifs qui tendent le micro aux citoyens/usagers), en encourageant élus et services à se rendre attentifs à la réception des projets portés par la collectivité.
A Palaiseau, l’atelier visait à faire le bilan du déploiement expérimental d’une piste cyclable bi-directionnelle qui s’est rapidement retrouvée contestée. Au lieu d’envoyer une agence de concertation pour désamorcer la contestation naissante, nous avons proposé aux participants à l’atelier (élus et techniciens) d’aller eux-mêmes mener l’enquête pour comprendre la réception du projet. Certains sont allés observer les usages sur place, d’autres ont analysés les publications Facebook, d’autres encore ont fait du porte-à-porte…

En croisant les regards l’atelier a été l’occasion de confronter ces différents capteurs de manière à construire un panorama des réactions qui soit le plus représentatif possible face au risque de survisibiliser ceux qui geulent le plus fort (même s’ils sont parfois très peu nombreux). En se rendant attentif aux signaux plus discrets, l’exercice a aidé les élus à aller au-delà du match entre les pro-vélo (fortement représentés au sein du comité dédié) et les anti-vélo (très actifs sur les réseaux sociaux) pour donner à voir tout le continuum des réactions.
Se mettre en posture d’écoute, c’était aussi l’enjeu des ateliers lyonnais organisés en miroir des sessions de la convention citoyenne. Avec la conviction qu’il n’y a pas besoin d’attendre la remise de l’avis citoyen pour s’interroger entre élus sur ce qu’on en retient et la façon dont ça nous interpelle. Il s’agissait aussi d’aider les élus à surmonter leur biais de confirmation, en se rendant attentifs à toutes les dissonances et les « je n’avais pas vu les choses comme ça ». Le contenu des échanges entre citoyens, marqués par la défiance vis-à-vis des injonctions des acteurs publics et leur volonté d’aborder les questions financières, ont ainsi alimenté les discussions entre élus sur la façon de positionner une une politique métropolitaine d’adaptation et d’argumenter sur son rendement attendu.
Pas forcément besoin de faire parler les usagers pour se mettre à leur écoute. C’est en tout le cas le constat qui ressort du travail avec Mutlog : une analyse du fichier client ou des relevés de sinistres sera tout autant (si ce n’est plus) riche d’apprentissage qu’une enquête de satisfaction. Par exemple pour repérer le profil des adhérents qu’on n’entend jamais et prendre conscience du poids qu’ils représentent.
Conseil pratique : demander à chaque participant au COPIL de venir avec son rapport d’étonnement
Et si, en lieu et place du powerpoint à rallonge préparé par les services, la mise de départ des COPIL prenait la forme d’un tour de table rapide sur un sujet ciblé (et annoncé en amont) :
« ce que j’ai le plus entendu »
« ce qui m’a le plus surpris »
Débuter le COPIL par le partage des rapports d’étonnement, c’est un moyen d’assumer la subjectivité de chaque récepteur… et de souligner la nécessité d’un échange collectif ! C’est en confrontant ses perceptions avec celles des autres que chacun parvient à surmonter ses biais et à être plus représentatif de la diversité des acteurs concernés par le sujet.
Mettre à contribution les participants sous la forme d’un rapport d’étonnement informel est aussi un moyen de montrer qu’un COPIL, ça se prépare. Et que ce qui fait la légitimité de la parole des élus, c’est leur capacité à se mettre à l’écoute de ce qui remonte du terrain et à s’en faire le relai auprès de l’administration
Ce qui reste à travailler : les outils d’aide à la représentation
Quels sont les outils disponibles pour permettre aux élus d’assurer leur fonction représentative et de capter la diversité des réactions ? Quels sont les biais produits par les réseaux sociaux dans la façon qu’ont les élus de se représenter les préoccupations des habitants ?
Les collectivités consacrent beaucoup d’énergie à développer des outils d’aide à la décision pour accompagner le travail des élus (notes d’enjeux, diagnostics, scénarios…). Pour démocratiser l’action publique, on gagnerait à en faire autant sur les outils d’aide à la représentation !
4/ On a besoin de COPIL pour prendre le temps de debriefer collectivement
Une des surprises de l’expérimentation COPILOTE, c’est l’importance des temps de debrief. Cela peut paraître comme une évidence, sauf que c’est loin d’être le cas ! Il y a un vrai enjeu à penser la place des debriefs collectifs dans la fabrique de l’action publique, pour faire exister cet espace entre le formalisme des instances officielles et le caractère fragmenté des discussions de couloir.
L’expérience des ateliers lyonnais était intéressante : il s’agissait de se mettre à l’écoute de ce qui ressortait de la convention citoyenne… sans jamais assister aux échanges entre les conventionnels (ni nous ni la plupart des VP présents aux ateliers n’étions présents aux sessions de la convention). Il nous fallait saisir les apports de ces expressions citoyennes uniquement par ce que nous en rapportait les organisateurs.
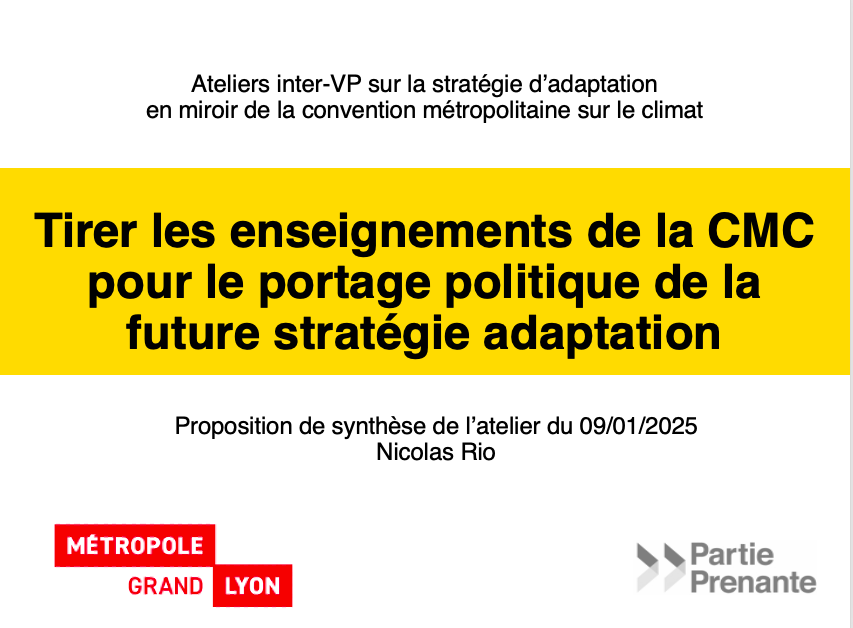
Ce qui pouvait être perçu comme un handicap s’est avéré être un atout. Parce qu’il agit comme un temps d’écoute en décalé, le debrief invite à prendre le temps de comprendre sans chercher immédiatement à répondre (c’est trop tard pour réagir, la session a déjà eu lieu). C’est un moment de prise de recul destiné à faire exister ce qui mérite d’être entendu et pris en compte, en obligeant ceux qui étaient là à faire le tri dans ce qu’ils en retiennent (le rapport d’étonnement évoqué ci-dessus) et en attisant la curiosité des autres, justement parce qu’ils n’y ont pas assisté. L’atelier de Palaiseau reposait sur le même principe, en confrontant les retours des élus/agents en première ligne de la contestation de la piste cyclable (le VP mobilité, l’adjoint du quartier concerné et le VP en charge de l’animation des conseils de quartiers) avec ceux qui regardent le projet de plus loin, notamment tous les élus sans délégation.
C’est bien parce que ces temps de debrief se déroulent dans un espace abrité que la transformation collective devient possible (qui contraste avec la mise en scène formelle des COPIL où tout est déjà pré-écrit). C’est parce que les élus n’ont plus à être en représentation (personne ne les regarde !) qu’ils peuvent se laisser interpeller par les dissonances qui remontent des rapports d’étonnement.
Le debrief agit comme une invitation au lâcher prise dans le pilotage de l’action publique. Il vient déconstruire le fantasme des COPIL stratégiques, qui seraient toujours à l’impulsion pour fixer les orientations politiques une bonne fois pour toutes. En réalité, les orientations se construisent autant à l’extérieur de la collectivité, à travers toutes les réactions que génèrent la réception des politiques publiques. La politisation de l’action publique, les élus la reçoivent bien plus qu’ils ne la fabriquent. Pour éviter de la subir (et réduire le décalage entre la théorie élaborée en COPIL et la réalité sur le terrain), cela nécessite de prendre le temps de l’accueillir et d’en comprendre les ressorts.
A Palaiseau, le debrief a par exemple permis de requestionner le fait d’associer développement du vélo et apaisement de l’espace public. Pour de nombreux usagers, la piste cyclable apparait comme une source de stress. La question n’est pas de savoir s’ils ont raison ou tort, mais quelles sont leurs raisons de le penser (qui entremêlent l’objectif et le subjectif) et comment faire pour corriger la situation.
Le debrief en réunion de majorité a également permis de souligner un flou ressenti autour de la notion d’expérimentation portée par le plan vélo. Une dissonance est apparue, face à des interpellations de terrain disant aux élus « vous présentez la piste cyclable comme une expérimentation, mais êtes-vous réellement prêts à revenir en arrière en cas d’échec ? ». Et les élus eux-mêmes, devant alors se questionner en détail sur la part de l’expérimental sur laquelle qu’il est possible de faire évoluer une fois les travaux engagés.
Conseil pratique : compléter le traditionnel relevé de décision par un relevé d’indécision
« Quelles sont les 5 questions en suspens qu’il faut prendre le temps de laisser décanter ou sur lesquels on a besoin d’objectivation ?
L’enjeu c’est de faire exister des questions sur lesquelles on n’a pas la réponse tout de suite. Laisser place aux doutes (sur le projet comme sur la façon de le porter) au lieu de vouloir trop vite les faire disparaître, avec le risque qu’ils vous reviennent en boomerang.
Reste à travailler : la façon dont ce travail d’écoute transforme la communication des collectivités.
A chaque fois, la volonté de prendre le temps de l’enquête et du debrief s’est heurté au même obstacles : la communication. Avec toujours la même injonction à répondre immédiatement, à répliquer à la moindre contestation et/ou à faire des annonces pour montrer que « les citoyens » ont été entendu… au risque d’alimenter un dialogue de sourds.
Pour que la communication puisse avoir lieu, il faut d’abord prendre le temps d’appuyer sur pause (au moins le temps d’un debrief, qui peut être faire en moins d’une heure) et apporter la preuve que les informations circulent dans les deux sens. On n’a pas encore trouver les moyens d’engager le dialogue avec les directeurs de la communication (et les cabinets) sur le sujet, mais il y aurait matière.
5/ On a besoin de COPIL pour construire l’argumentaire face aux injonctions contradictoires des citoyens / usagers
A l’issue de l’expérimentation COPILOTE, on en ressort plus au clair sur notre hypothèse de départ. Si les collectivités ont besoin d’espace de politisation (que ce soit des COPIL, des ateliers-élus ou autre), ce n’est pas pour le plaisir de cliver ni pour mettre des battons dans les roues des services, mais pour aider les acteurs publics à gérer une politisation qui est déjà-là.
La politisation n’est pas toujours explicite, elle s’exprime à travers toutes les injonctions contradictoires auxquelles sont confrontées les collectivités et leurs élus. C’était marquant à Lyon, lors de la convention citoyenne sur l’adaptation : dans leur adresse à la Métropole, les conventionnels revendiquent une exigence d’efficacité mais un refus de la contrainte, lui reprochent d’en faire trop et de ne pas en faire assez, affirment que le sujet n’est pas prioritaire tout en critiquant la collectivité de ne pas l’avoir assez anticipé, etc…
Face à cela, il est impossible de dire oui à tout. Cela nécessite d’assumer de faire des choix, de trouver des points de compromis acceptables là où le consensus n’existe pas, de chercher la cohérence pour rendre l’action publique lisible et compréhensible… En se focalisant sur les points qui apparaissent comme les plus controversés suite au travail d’écoute.
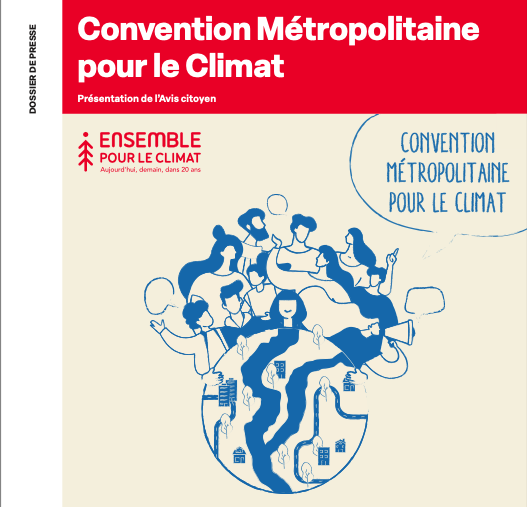
– Convention citoyenne de la Métropole de Lyon
Les COPIL ont bien une fonction d’arbitrage, mais pas forcément au sens où on l’entend d’habitude : il ne suffit pas de choisir tel scénario ou d’affirmer une position, l’enjeu consiste surtout à pouvoir argumenter politiquement les choix retenus pour les rendre démocratiquement robustes : « au nom de qui et de quoi a-t-on choisi de prendre cette décision ? »
Cela suppose d’incarner les bénéfices de l’option retenue pour être capable d’en démontrer la pertinence et d’apporter des réponses aux objections entendues pour démontrer qu’elles ont été prises en compte. En somme, il s’agit d’avoir autant d’exigence sur l’instruction politique que sur l’expertise technique : réunir des éléments de preuve pour argumenter leurs choix.
Cela demande du temps et de l’énergie. Mais c’est aussi un moyen de sécuriser la prise de risque consubstantielle à toute action politique. Plus exigeants pour ses participants, les COPIL deviennent aussi plus utiles pour réduire la vulnérabilité des élus et augmenter leur pouvoir d’agir.
Conseil pratique : lister les « considérants » qui justifient l’option retenue
Les « considérants… » qui ouvrent chaque délibération publique ont fini par devenir une formule purement bureaucratique. Elle gagnerait pourtant à être réinvestie pour expliciter ce qui a motivé les décisions prises.
L’idée serait, pour chaque décision controversée, de produire la liste des 10 « considérants » qui la justifie (comme un moyen de résumer les discussions qui ont eu lieu en COPIL), en pointant à la fois :
les raisons qui conduisent la collectivité à agir sur le sujet : « considérant la nature / l’ampleur du problème, voilà pourquoi nous avons décidé de… »
la façon dont les principales objections ont été prise en compte et ont conduit à ajuster la décision finale : « considérant les objections entendues, voilà en quoi elles ont été intégrées dans le compromis proposé… »
Reste à travailler : l’argumentaire démocratique des décisions
Travailler la justification des décisions en listant les « considérants » pour rendre visible le travail d’instruction politique qui a été conduit, voilà ce que nous n’avons pas eu le temps de faire dans le cadre de COPILOTE. Notamment car l’expérimentation a pris fin avant que ce travail d’instruction politique ne débouche sur des décisions (sur le déploiement des pistes cyclables à Palaiseau ou sur les moyens de s’adapter aux pics de chaleur au Grand Lyon).
Ce serait pourtant un bon moyen d’encourager les élus et leurs collaborateurs à formuler devant les citoyens ce qu’ils retiennent sur le fond de ce processus d’écoute. Un peu l’équivalent du droit de suite en matière de participation citoyenne, mais du côté de la réception des politiques publiques.
Deux remarques en guise de conclusion
Le défi de la collégialité entre élus
Pour renforcer la capacité d’écoute des institutions et faire entendre la diversité des préoccupations, cela nécessite de travailler à plusieurs. Plus facile à dire qu’à faire, car dans le fonctionnement actuel des collectivités locales, la collégialité reste un défi !
Au niveau des élus, cela suppose de compléter la division du travail thématique où chaque adjoint/vice-président se concentre sur « sa » délégation (et préside seul les COPIL sur « ses » sujets) par des espaces plus collectifs capables d’organiser le croisement de regards (où chaque voix compte car elle apporte une lecture de la situation que les autres n’ont pas). Ces échanges existent, mais ils dépendent du bon vouloir de la tête de l’exécutif et leurs apports ne sont pas assez valorisés, ce qui fait qu’ils sont souvent rétrogradés dans la hiérarchisation des tâches d’élus surbookés.
Au niveau de la fabrique de l’action publique, cela nécessite de clarifier le partage des rôles pour permettre à chacun de jouer sa partition sans marcher sur les plate-bande des autres. Et ce, dès le début de la mandature. En mettant l’accent sur l’enjeu démocratique, il s’agit de démontrer à chaque acteur en quoi il a besoin des autres : les services ont besoin des élus pour sécuriser la faisabilité politique de leurs actions, le maire a besoin de son exécutif pour éclairer les injonctions contradictoires, l’exécutif a besoin des autres élus pour faire remonter les dissonances à prendre en compte, etc.
Le défi des agendas d’élus déjà bien surchargés
« Renforcer la place de l’instruction politique dans la fabrique de l’action publique, c’est bien mais ça demande du temps. Et les élus n’en ont pas ! » Voilà le principal retour qu’on nous a fait, durant l’expérimentation et à la lecture de ses enseignements. Nous sommes bien conscients du défi, dans un contexte où un nombre croissant d’élus se retrouve en burn out. Mais :
Un bon debrief collectif est souvent bien plus rapide qu’un COPIL protocolaire au tour de parole interminable ! Pour avoir le temps de débattre, il faut aussi réduire ou supprimer les formats imposés d’une délibération aussi fake que chronophage.
Instruire la réception des politiques publiques, les élus le font déjà. Mais ce travail se fait souvent une fois que la situation est bloquée, obligeant les élus à sauter d’une crise à l’autre alors qu’elles auraient (parfois) pu être désamorcées en amont.
Renforcer l’exigence sur la qualité de l’instruction politique des dossiers, c’est aussi un moyen de redonner du sens à la fonction d’élu (qui sont nombreux à se demander à quoi ils servent ou à se réfugier sur la posture du super-technicien sans en avoir le temps ni le statut).
Démocratiser les COPIL, c’est aussi inviter les élus à revoir leur hiérarchisation des tâches pour les décharger de ce qui ne correspond pas à leur fonction. Et convaincre les services sur le fait qu’il existe d’autres modalités pour mieux coopérer avec ceux qui sont en charge de représenter leurs concitoyens.
