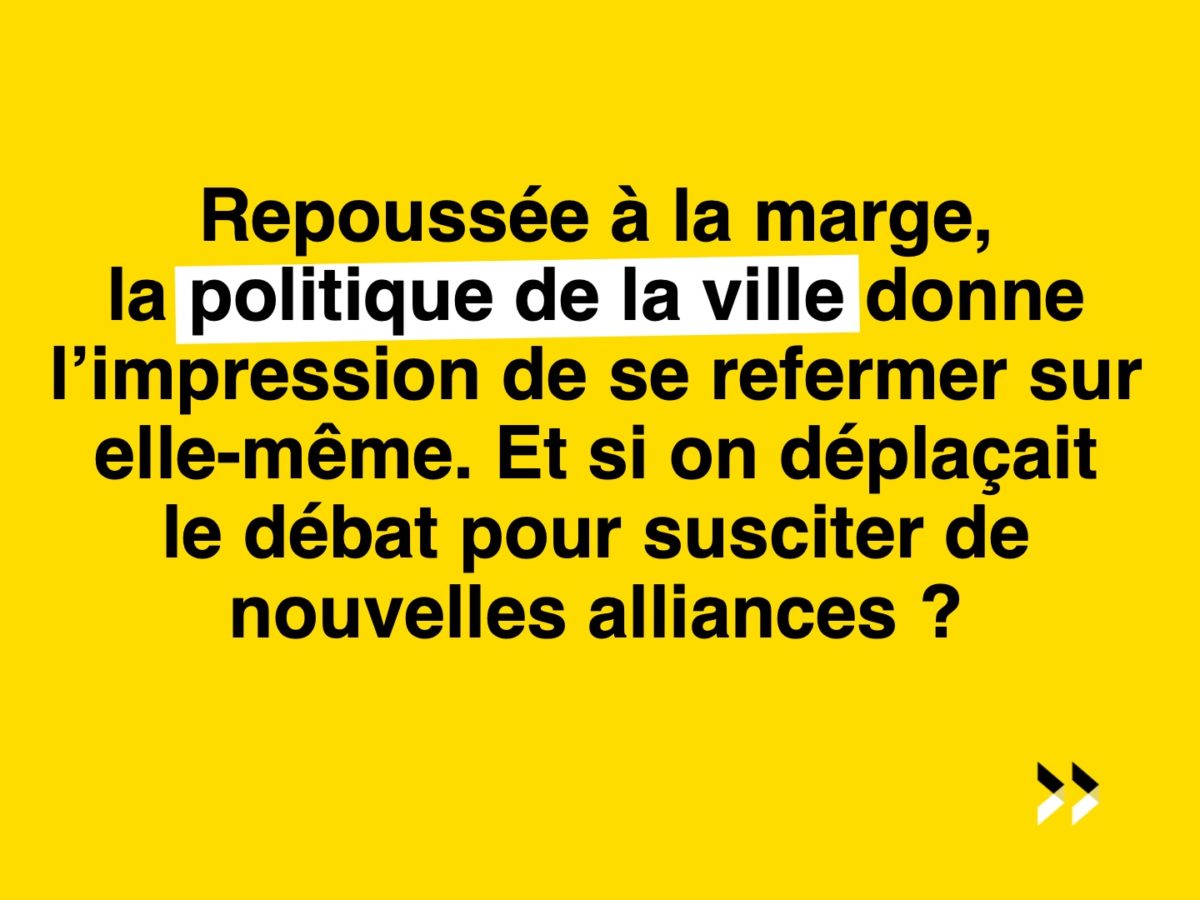« Bonjour, c’est le ministère en charge de la ville. Seriez-vous d’accord pour participer à une audition d’experts pour la commission sur l’avenir des contrats de ville ? » A Partie Prenante, nous ne sommes pourtant pas des spécialistes des quartiers populaires, même si on a été biberonnés par Estèbe, Behar et Epstein lors de notre passage à Acadie. Mais on s’est pris au jeu de la question posée. Si bien qu’on se retrouve en 2022 avec trois chantiers sur le sujet : l’animation d’un groupe de travail pour Profession Banlieue sur le renforcement des coopérations dans la politique de la ville, l’évaluation du Contrat de ville de Brest Métropole sous l’angle de la gouvernance et un projet de recherche-action avec la 27e Région pour l’ANCT pour redesigner l’objet « contrat » au service de celles et ceux qui le mettent en œuvre au quotidien.
Six mois après notre audition, alors que la commission a rendu son rapport et qu’un nouveau ministre a été nommé, on avait envie de vous partager notre rapport d’étonnement sur l’état de la politique de la ville. Spoiler : c’est pas la joie, mais on a tous un rôle à jouer pour remettre les quartiers populaires au cœur de l’action publique urbaine.
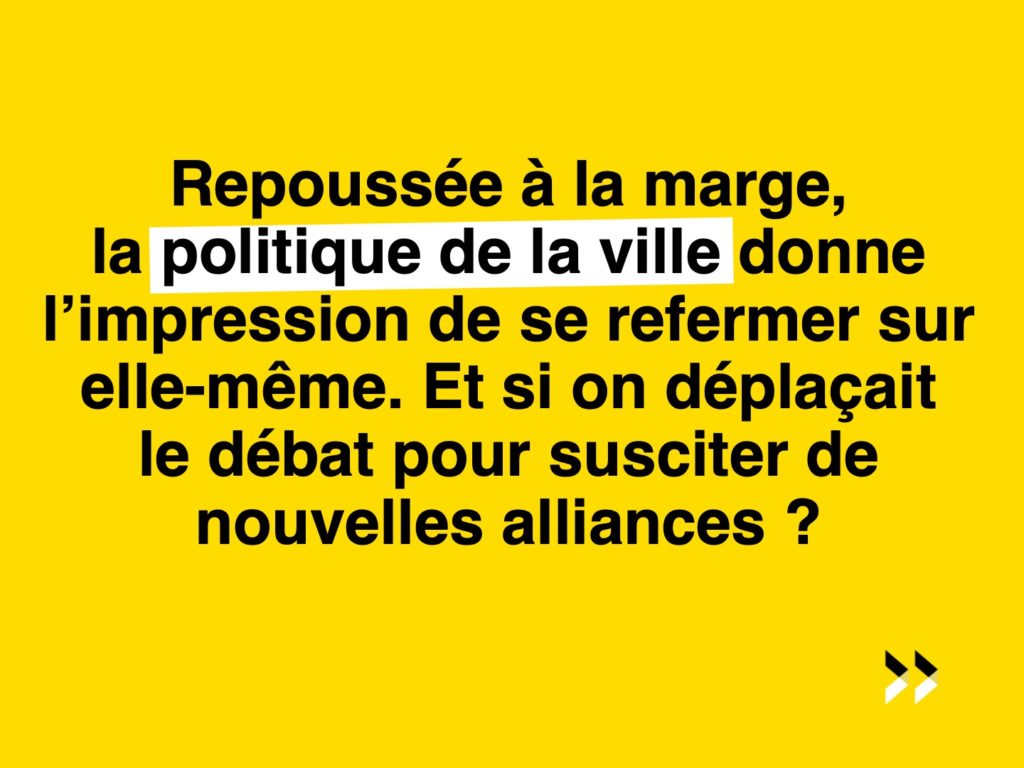
Les quartiers, une géographie de moins en moins prioritaire
Lors de notre « audition » sur l’avenir des contrats de ville, on était venu avec une hypothèse simple (et largement partagée) : la politique de la ville est en voie de marginalisation. Les quartiers « prioritaires » n’ont jamais aussi mal porter leur nom !
A force de mettre l’accent sur les villes moyennes en déclin et les territoires ruraux abandonnés par l’Etat, la question du besoin d’action publique dans les quartiers populaires a disparu du débat public. Par désintérêt ou par défaitisme, plus personne n’ose aborder le sujet. Nous les premiers : en cinq ans d’existence, on a multiplié les papiers sur la revitalisation des cœurs de ville et les nouveaux enjeux de la ruralité, mais rien sur les banlieues ! Malheureusement, on est loin d’être les seuls à être soumis aux effets de cycle de l’agenda politico-médiatique. Cette marginalisation se retrouve dans les projets de territoire élaborés par les collectivités. Alors que la politique de la ville constituait un chapitre important (voire un axe directeur comme à Plaine-Commune ou à Nantes), c’est devenue une thématique annexe.
Les explications sont multiples : diminution du poids politique des quartiers populaires avec la hausse de l’abstention et le changement de profil des élus locaux, sentiment d’épuisement et d’impuissance face à la persistance des inégalités urbaines, crainte du procès en communautarisme… Mais les perdants sont toujours les mêmes : les habitants des QPV.
La démonétisation de la politique de la ville n’est pas que symbolique, elle est aussi financière. La géographie prioritaire est devenue une politique de gestion de la pénurie, marquée par un effet de ciseaux entre la baisse des crédits et la hausse des difficultés. Le Covid a pourtant montré l’intensité des situations de précarité dans les quartiers populaires (mal-logement, difficulté d’accès aux droits et à la santé, vulnérabilités aux chocs économiques, exclusion numérique…). Le retour de l’inflation et la multiplication des canicules ne vont pas améliorer les choses.
Au-delà des crédits spécifiques alloués à la politique de la ville (dont une bonne partie est absorbée par la rénovation urbaine), les quartiers populaires se retrouvent en première ligne de l’effritement de l’Etat-providence et de la crise des services publics. Education, santé, justice, police… l’austérité laisse des traces. « Les élèves scolarisés dans l’académie de Créteil perdent en moyenne une année de scolarité obligatoire du fait d’absences de professeurs non remplacés » pointe par exemple le rapport de l’Institut Montaigne. Depuis le rapport des députés Cornut-Gentille et Kokouendo sur l’action de l’Etat en Seine-Saint-Denis publié en 2018, cette inéquité de l’action publique est désormais reconnue (à défaut d’être quantifiée). Mais l’électrochoc n’a pas eu lieu : politiquement et médiatiquement inaudible, ce constat semble être resté sans conséquences.
Sur le terrain, cette gestion de la pénurie se traduit par une externalisation aux associations des missions de services publics. Les appels à projets se multiplient pour confier aux associations le soin de prendre en charge à coûts réduits les problématiques des quartiers populaires, de l’enseignement du français à l’accès à l’emploi, en passant par la rénovation énergétique ou l’offre culturelle.
« On n’arrive plus à recruter ! »
Ce qui nous marque le plus dans nos échanges de ces derniers mois avec les acteurs du développement social et urbain, c’est les conséquences de cette démonétisation sur les professionnels du secteur. « On n’arrive plus à recruter » nous disent toutes les collectivités. Au-delà des conditions salariales peu avantageuses, c’est aussi la perte d’attrait de la fonction qui est mise en avant du fait de la bureaucratisation du métier. « Etre payé au lance-pierre pour passer son temps à instruire des dossiers et naviguer entre des injonctions contradictoires, je peux comprendre que ça ne fasse pas rêver. » On ne peut s’empêcher de faire le lien avec le cri d’alarme en cours du côté de l’Education nationale, avec sa difficulté à trouver de nouvelles recrues (difficulté qui touche d’ailleurs « en priorité » les quartiers populaires, Seine-Saint-Denis en tête). Comme pour l’école et l’hôpital, la politique de la ville risque à son tour de buter sur un problème de ressources humaines.
Cette troisième démonétisation est la conséquence des deux premières, mais c’est sans doute la plus préoccupante car elle produit des effets dans la durée. La politique de la ville n’a jamais eu d’argent, mais elle avait des idées avec le droit de faire différemment. L’implication et la reflexivité de ses élu.e.s et de ses professionnel.le.s de terrain constituait son principal patrimoine. Mais si tout le monde déserte la politique de la ville, que va-t-il en rester ?
C’est pour éviter cette mort à petit feu qu’on se dit qu’il est temps de replacer les quartiers populaires au cœur de l’action publique urbaine. En considérant qu’on n’a pas besoin d’être un spécialiste de la politique de la ville pour prendre notre part de ce combat à contre-courant. En réalisant aussi que défendre la politique de la ville, c’est avant tout prendre soin des acteurs de terrain qui la mettent en œuvre au quotidien. A sans cesse alerter sur la situation sociale des quartiers prioritaires, on finit par en oublier la précarité et l’implication de toutes celles et ceux qui y interviennent pour faire tenir l’action publique. « Plus de considération, moins d’injonctions » pourrait-on lire sur les pancartes de la manifestation qui rassemblerait tous ces agents de terrain s’ils n’étaient pas dispersés dans chaque quartier. Car comme les enseignant.e.s, les infirmier.e.s ou les travailleurs sociaux, ces professionnel.le.s se retrouvent malgré eux en première ligne de ce tournant austéritaire et des contradictions de la puissance publique.
Mais à notre échelle, qu’est-ce que ça voudrait dire « d’aider les aidants » des quartiers défavorisés ? On cherche encore la réponse. Sans doute cela commence par arrêter de vouloir réinventer la politique de la ville, en s’attachant plutôt à relayer les difficultés des chefs de projets DSU et à explorer avec eux des chemins de traverse. On se dit que l’enjeu est surtout de dépasser le sentiment de découragement, face au décalage entre l’ampleur des difficultés et la faiblesse des moyens. C’est cette impression qui nous saisit en relisant sept ans après le rapport Bacqué-Mechmache : comme si tout avait déjà été dit (et redit), et que rien ou si peu n’a été fait. Parfois, on se demande même si ce qui a été fait n’a pas davantage contribué à renforcer le problème qu’à le résoudre (sur la mise en place des conseils citoyens comme sur le financement pluriannuel des associations par exemple).
Déplacer le débat pour susciter de nouvelles alliances
Repoussée à la marge, la politique de la ville donne l’impression de se refermer sur elle-même, en agitant toujours les mêmes mots d’ordre et en accusant le reste du monde d’être la cause de son déclin. S’il peut contribuer à maintenir l’identité professionnelle du DSU, ce réflexe défensif risque selon nous d’accentuer l’isolement qu’il dénonce. Pour contourner ce cercle vicieux, on se demande s’il ne faudrait pas s’écarter des mots d’ordre historique de la politique de la ville (la contractualisation Etat-collectivités, la participation des habitants et la mobilisation du droit commun) pour chercher à tisser de nouvelles alliances.
Déplacement #1 : la contractualisation entre l’Etat et les collectivités
Responsabilité régalienne autant que levier de développement local, la politique de la ville est incontestablement à cheval entre ces deux puissances publiques. Il est essentiel que ces deux institutions coordonnent leurs actions et prennent leur juste part pour assurer le dernier kilomètre de l’Etat-providence dans les quartiers. Mais sur le terrain, on constate que cette négociation finit par absorber l’essentiel de l’énergie, aux dépens de la capacité d’action publique dans les quartiers populaires.
Elle enferme le fonctionnement de la politique de la ville dans un face-à-face asymétrique où les acteurs locaux sont sans cesse contraints d’attendre les directives nationales d’un Etat qui peine à trouver son cap et à le tenir dans la durée. On le voit sur l’évaluation des contrats de ville et la préfiguration des prochains : l’essentiel des discussions portent sur le calendrier et sur les procédures au lieu de se focaliser sur l’évolution des besoins et l’amélioration des actions engagées.
Cette tension limite la capacité à construire du commun localement avec le risque permanent que les initiatives déployées sur le terrain (par les chefs de projet comme par les délégués du préfet) se retrouvent contredites par des directives venues d’ailleurs. Au lieu de mutualiser les forces, cette co-production vient figer la situation. En donnant à chaque partie la possibilité de rejeter la responsabilité sur le camp d’en face.
Et si pour mettre en œuvre cette géographie prioritaire, on passait des instances imposées (qui n’ont parfois rien de partenarial) à une fabrique de coalitions à géométrie variable ? L’expérience des confinements a montré que les coopérations Etat-collectivités-associations pouvaient fonctionner, à condition de partir du problème pour définir les acteurs concernés et leur partage des rôles. La question du non-recours aux droits et aux prestations sociales apparaît comme une problématique centrale dans les quartiers qui pourrait servir de terrain d’entente.
Déplacement #2 : la participation citoyenne
Le pouvoir d’agir des habitants constitue le graal de la politique de la ville, sans cesse réaffirmé mais toujours plus inaccessible. A force de s’épuiser à tenir à bout de bras une offre de participation institutionnelle en décalage avec les pratiques des citoyen.ne.s concerné.e.s, la politique de la ville finit par accroître la défiance démocratique dans les QPV. D’une part, elle laisse dans l’angle mort l’épineuse question de la représentation politique des quartiers populaires, du Conseil municipal jusqu’à l’Assemblée nationale. D’autre part elle entretient l’image d’une action publique qui disfonctionne, incapable de tenir ses promesses et de reconnaître ses erreurs.
Pour éviter que la participation citoyenne se transforme en alibi du retrait des services publics dans les quartiers présentés comme prioritaires, cela donne envie de replacer la question des inégalités urbaines au cœur du débat. Et si les professionnels de la ville faisaient alliance avec les citoyens/usagers et les associations pour objectiver et incarner les inégalités de traitement que subissent les habitant.e.s des quartiers populaires et garantir sa mise à l’agenda de l’action publique (locale et nationale) ? Des inégalités sanitaires mise en lumière par le Covid jusqu’aux inégalités climatiques (dans l’exposition aux pollutions et la vulnérabilités aux canicules), les occasions ne manquent pas.
En mettant l’accent sur la lucidité et l’humilité, cette approche aurait le mérite de repolitiser l’action collective dans les quartiers populaires, au lieu d’euphémiser l’étendue du problème. La politique de la ville n’a pas vocation à « sauver les quartiers », elle n’en a pas les moyens. Sa mission consiste davantage à interroger – et à renforcer – l’équité de l’action publique.
Déplacement #3 : la mobilisation des politiques de droit commun
Tous les acteurs de la politique dénoncent l’absence de mobilisation du droit commun. Le couplet n’est pas nouveau, et il est loin d’être inexact : pour améliorer la situation des habitants des quartiers populaires, il est indispensable que chaque politique publique en fasse un territoire d’intervention prioritaire. Mais là encore, cette ritournelle finit par agir comme un boulet au lieu d’être un levier. Au sein des collectivités, elle empêche les coopérations entre la politique de la ville et les autres directions. Par crainte de venir se substituer au droit commun, les acteurs de la politique de la ville s’interdisent souvent d’initier des projets en lien avec d’autres champs sectoriels (la mobilité, la transition écologique…) et se retrouvent cantonner à la gestion de la vie associative des quartiers. Réticentes à l’idée qu’on leur fasse la morale sur la non-prise en compte des quartiers populaires, les autres directions des collectivités (et de l’Etat) se tiennent souvent à distance des équipes du développement social et urbain. Et ce alors qu’elles reconnaissent souvent être démunies pour bien comprendre les spécificités des besoins en QPV ou pour trouver les bons relais locaux pour décliner leur stratégie.
Comment passer du dialogue de sourds à la coopération équilibrée ? On n’a pas de recette miracle. La question de la transition écologique nous semble être un bon objet de travail pour organiser ce rapprochement. Que ce soit sur la neutralité carbone comme sur l’adaptation aux dérèglements climatiques, tous les services « écologie » des métropoles et des villes moyennes prennent conscience de renforcer la dimension sociale de leur stratégie de transition écologique. Par leur connaissance des quartiers et leur proximité avec leur tissu associatif, les équipes politique de la ville constituent une ressource précieuse.
Voilà la ligne de conduite qu’on se fixe pour l’instant : se mettre aux cotés des professionnels de terrain qui interviennent au quotidien dans les quartiers pour faire entendre leur voix, tout en aidant la politique de la ville à sortir de son carcan. On vous racontera ce que ça donne !